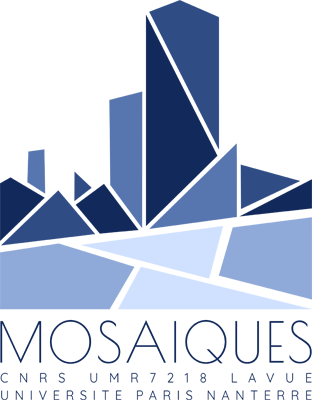Le laboratoire
Les travaux menés au sein de l’équipe Mosaïques portent sur les espaces urbains ou périurbains ainsi que sur les espaces ruraux dans leur relation à la ville. Ils s’intéressent aux processus affectant la matérialité des territoires, les jeux d’acteurs, les représentations de l’espace, les modes d’habiter ou encore les relations humains-nature. Il s’agit d’observer et d’expliquer les transformations contemporaines, tout en étant attentif aux effets de continuité sur le temps long. La dimension politique et les rapports de pouvoir occupent une place importante dans ces travaux. Ils sont notamment abordés à travers l’analyse des modes de gouvernement de et par l’espace, et l’évolution des formes de mobilisations et plus largement des dynamiques collectives liées au territoire. Les recherches menées au sein du laboratoire s’efforcent d’articuler des études de cas empiriques à l’analyse des processus de construction des politiques et de production des normes, dans une perspective critique.
L’identité du laboratoire repose sur plusieurs piliers : sa volonté de travailler en lien avec des acteurs institutionnels et associatifs pour contribuer aux débats sur les grands enjeux qui traversent le monde actuel ; et la dimension comparative, visant la mise en perspective de différents terrains européens, nord-américains et du Sud global.
Le laboratoire participe à plusieurs réseaux internationaux et a noué des collaborations privilégiées avec plusieurs équipes étrangères. Nourri de l’héritage d’Henri Lefebvre à l’université de Nanterre, il est notamment impliqué dans la revue la revue en ligne bilingue Justice spatiale/Spatial Justice : jssj.org
Le laboratoire Mosaïques est une équipe de l’UMR 7218 LAVUE.
Direction :
Sonia Lehman-Frisch
sonia.lehman-frisch@parisnanterre.fr
Adresse :
Université Paris Nanterre
Bâtiment Max Weber – 4ème étage
200 Av de la République
92001 Nanterre
Thématiques structurantes
Mosaïques fait partie de l’UMR 7218 LAVUE (Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement).
Le LAVUE se caractérise par une approche plurielle des espaces urbains, appréhendés dans leurs dimensions matérielle et idéelle, construite et processuelle mais aussi sociale, économique, environnementale et politique. Qu’il se situe dans les espaces centraux, péri-urbains ou en interface avec les espaces ruraux, le fait urbain est ainsi conçu comme un marqueur central des transformations contemporaines des sociétés. Il est envisagé à l’aune des pratiques professionnelles, habitantes et citadines.
Le LAVUE se distingue en outre par sa démarche scientifique : situées, co-construites et critiques, les recherches des membres du laboratoire s’appuient sur des études de terrain ouvertes à l’international, aux Nords comme aux Suds, ainsi que des partenariats divers, menés en particulier avec des collectivités territoriales, ainsi que des organisations sociales et citoyennes.
Les membres de Mosaïques s’inscrivent dans les quatre thématiques structurantes du LAVUE :
Acteurs, métiers et transformations de l’urbain
Au-delà de la dualité entre système néolibéral et expériences alternatives, les travaux du LAVUE appréhendent l’ensemble des acteurs urbains dans un continuum allant des habitant.e.s aux professionnels en passant par les actrices et acteurs institutionnels pour mieux questionner leurs pratiques et modalités d’organisation collective, ainsi que les effets de celles-ci sur la fabrique urbaine. Dans ce cadre, on s’intéresse notamment aux coopérations et aux négociations qui marquent les relations de travail pour l’élaboration des projets et la gestion du cadre bâti et aménagé. Une attention particulière est accordée à la manière dont les formations prennent en compte l’évolution des pratiques.
Habiter les changements globaux
Les travaux du LAVUE s’attachent à penser l’urbain – y compris dans ses interdépendances avec les espaces ruraux – dans un contexte de dérèglement climatique, d’érosion de la biodiversité, d’épuisement des ressources, etc., et d’adaptation à leurs effets. Dépassant le dualisme nature/culture, ils visent à s’interroger sur les transformations de l’environnement et des rapports des sociétés à celui-ci. Ils portent ainsi sur la façon dont les territoires locaux sont affectés par des mutations planétaires, contribuent à les produire et y font face. Pour ce faire, nous nous intéressons aux politiques publiques, aux discours, aux normes et aux mobilisations environnementales. Nous questionnons la manière dont les modalités de l’habiter et du co-habiter, les relations entre les humains et non-humains, sont transformées par ces changements.
Inégalités, (in)justices et résistances
Dans un monde où les inégalités s’intensifient et génèrent de plus en plus de craintes et de tensions sociales et démocratiques, les questions de justice sociale et spatiale se posent avec une acuité renouvelée. Nos travaux interrogent les évolutions ou les transformations de ces inégalités, les mécanismes de pouvoir et de domination qui se déploient (ou non) dans l’espace, les formes de résistances et les pratiques d’émancipation émergentes. Ils visent ainsi à construire des approches critiques et attentives à la dimension politique de nos objets de recherche.
Savoirs partagés et méthodes comparées
Cherchant à aller au-delà de l’impératif participatif, nous nous interrogeons sur les manières de caractériser et de construire les savoirs urbains afin que ceux-ci soient véritablement partagés et mobilisés. Nous associons des moments de formation à ces méthodes et des temps de retours réflexifs sur celles-ci en nous appuyant sur les programmes de recherche collaboratifs portés par le laboratoire. Nous questionnons ainsi les effets de ces méthodologies sur les types de savoirs produits, la recherche elle-même et la société dans son ensemble.